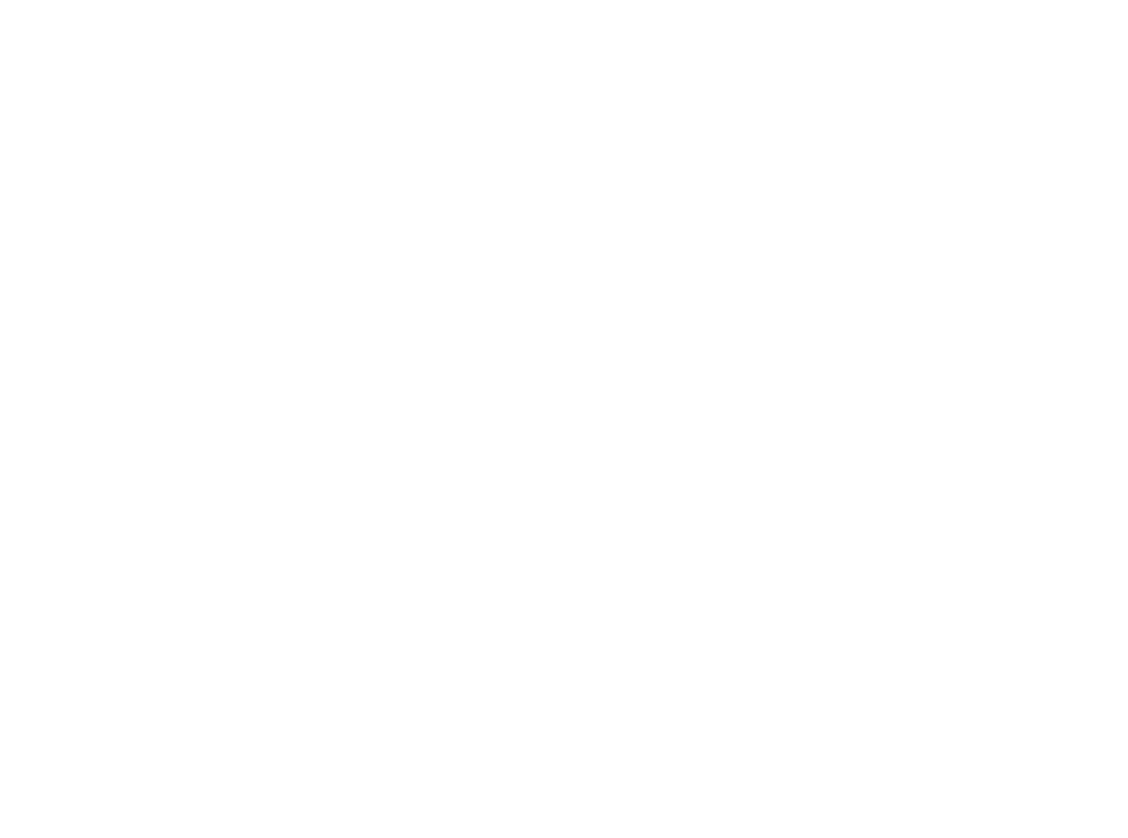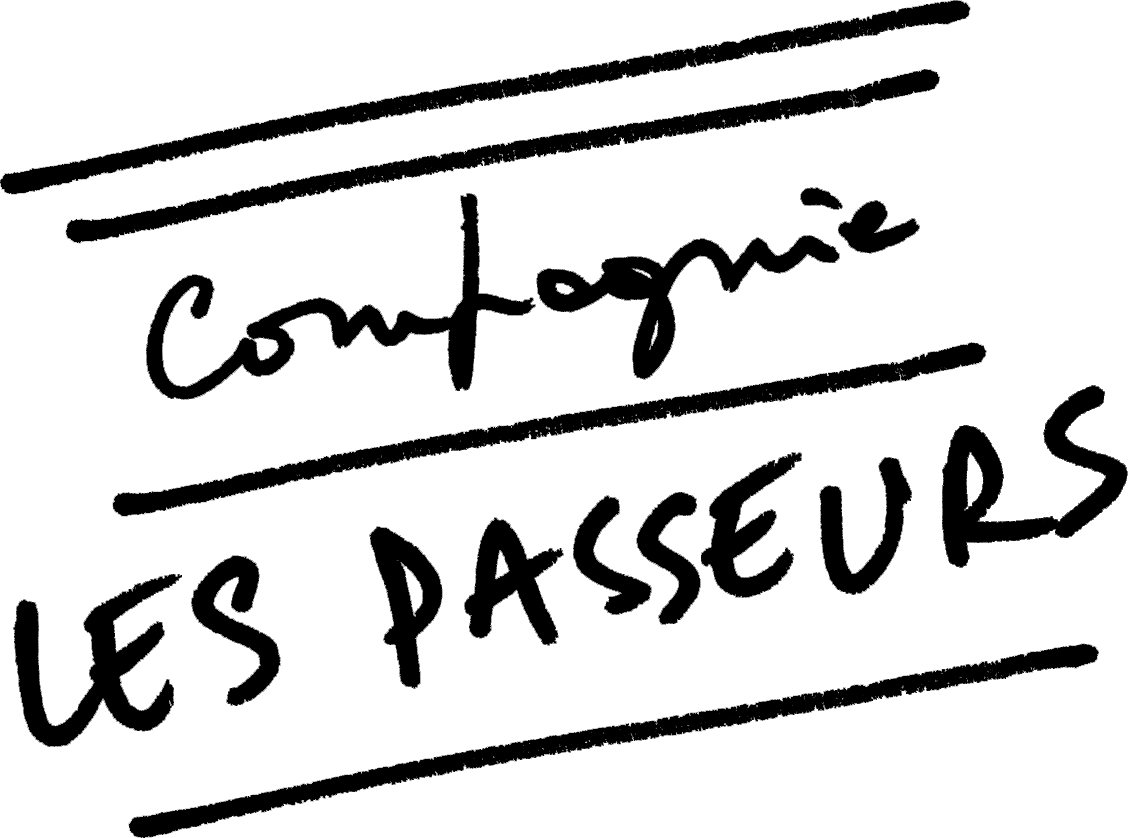Être ou ne pas être au travail. Telle est la question.
Être. Exister. Avoir une identité, un corps, un sens, une densité. Avoir un travail pour mieux être.
Mais être quoi ? Qui ? À quel prix ?
Le travail.
Le travail n’est plus ce qu’il était. Le travail inhumain devenu trop humain, en apparence du moins.
Le travail confortable, modernisé, tiède, convivial, organisé. Le travail qui n’en a pas l’air et pourtant
resserre son étreinte, imperceptiblement. Et l’on redouble de ruses pour mieux l’ignorer. D’orgueil
aussi. Car nous rêvons encore d’épreuves réussies, de défis relevés, aussi herculéens soient-ils,
nous voulons être des athlètes, tenir la cadence, remporter l’objectif, à notre minuscule niveau,
devenir quand même, un peu, des héros. On ne compte plus nos heures. On donne de nous-mêmes.
Et demain ? Il faudra faire encore. Mieux. On prend goût à l’intensité, factice mais palpable. Impression de transfigurer la banalité. De faire mieux. Le reste, peu à peu, à défaut de bonheur, pâlit.
Travailler, enfin, nous manque. Tension.
Nous et nos grands habits neufs d’empereurs.
Nous et notre mensonge immense, pathétique.
Nous si honteux de nous qui ne sommes que nous.
L’addiction, lentement, s’insinue en nos vies. L’addiction à cet état de vainqueurs, de compétiteurs.
À cette illusion du dépassement. À cette interminable vibration qui ne laisse plus place à la pensée,
au doute, à la fragilité. Mais c’est sans plaisir que nous planons. Pas d’orgasme dans le job. Aucune
désinhibition. Pas le plus petit instant de détente, d’oubli. Au contraire : le trip est concentration,
précision, érection, accumulation. Une excitation infinie sans la libération du jouir. Alors, à quoi nous
accrochons-nous à ce point ? Quel profit tirons-nous de cette dépendance ? Quelles en sont les
conséquences ? Imposer à tout son être une telle gangue ne peut se faire sans éclatement.
Une femme (monologue).
Elle parle. Elle est fière, férocement joyeuse, cynique, infatigable. Elle n’a aucun problème, dit-elle.
Elle a tout. Elle exulte, comblée. Dit-elle. On la croit. C’est une femme dont le langage lui-même
semble sans cesse s’écarter pour mieux la dépasser, l’éviter, l’évincer. Un langage conquérant,
engloutissant. Une femme dont la parole est elle-même travail, incessant labeur, voué à construire
des édifices chaque fois plus complexes pour masquer ce rayon de jour, cette sincérité qui révélerait
tout. Elle pense, organise et diffuse sa description d’elle-même et du monde pour maintenir l’illusion
fragile de son existence, la spectaculaire mise en scène de sa propre vie.
À travers cette accumulation, perce peu à peu la faille qui la lézarde, silencieusement. D’abord, un
vacillement. Ce léger glissement que l’on rabat d’un geste afin de chasser l’encombrante vérité.
Celle du corps, du rythme cardiaque, de l’émoi, du souffle. Celle de la vie vécue. Malgré elle, les
démons tenus à l’écart imposent leurs transgressions sauvages. Il y a désobéissance pour qui a
trop obéi. Elle se contredit, se contrecarre, s’absurde. Cela peut être drôle car il nous faut en rire,
secouer hors de nous les peaux ridicules. Tout cet attirail d’apparat et son bruit de breloques
sonnant faux. Ainsi elle est un monstre de joie et de pouvoir, une enfant qui gribouille, une femme
puissante, un réservoir de honte, une beauté qui s’ignore, un grand vide, parfois à peine debout.
Et lorsque, sans prévenir, son cerveau épuisé implose, court-circuitant la raison même, la voici
traversée de poésie brute, défiant magnifiquement ce monde de bureaux, effrayant et grotesque.
SOPHIE LANNEFRANQUE, FÉV. 2017